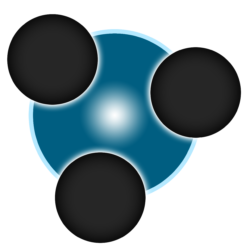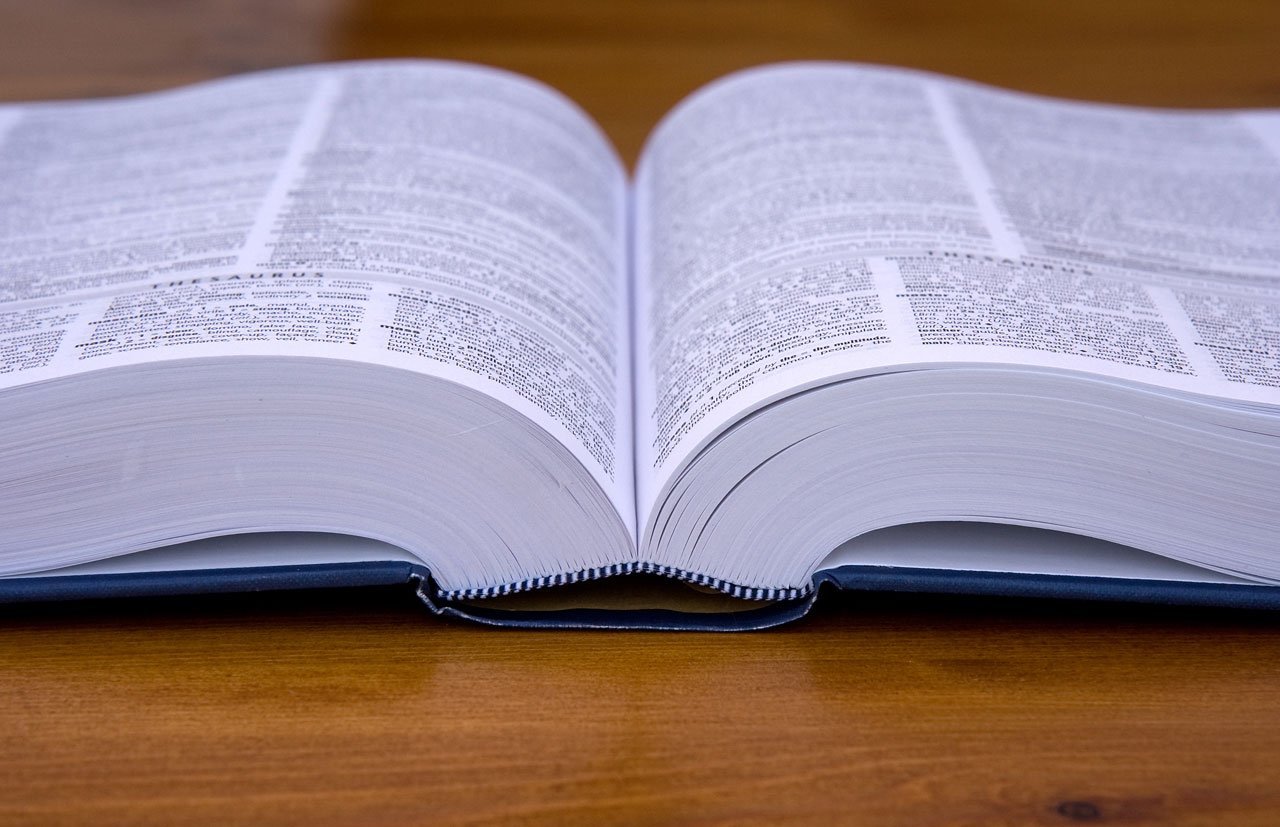Les différents articles portent sur des sujets dont les termes peuvent parfois entraîner des équivoques ou incompréhensions. Vous trouverez ci-dessous les définitions retenues afin d’aborder les textes avec une terminologie que nous aurons en commun.
Être pensant
Constitution biologique douée d’intelligence.
Empathie
L’empathie est la faculté de ressentir les mêmes impressions qu’un autre être pensant, ou par extension de les comprendre et en accepter la valeur.
Nous pouvons utiliser le terme d’ « empathie » pour qualifier le sentiment d’humanité et compréhension de l’autre porté à tous les êtres pensants.
Égoïsme
Caractère d’un être pensant consistant à rapporter la majorité des éléments traversant sa vie à lui-même.
Narcissisme
Fierté et/ou amour de soi plus importants que ceux portés à autrui.
Science
Ensemble de disciplines permettant d’expliquer des phénomènes dans un certain contexte, de manière logique. Le contexte et les explications de la science sont limités par l’intelligence et la technologie des êtres pensants. Nous n’appelons ici « sciences » que les sciences formelles et naturelles.
Vérité
Caractère de ce qui est vrai, réel, dans un contexte donné. La vérité est une qualification ne faisant pas nécessairement appel à un raisonnement. Une vérité peut ainsi exister sans même avoir été observée, comprise ou prouvée logiquement.
Conscience
La conscience pourrait être définie de plusieurs manières. Une personne peut se considérer comme consciente dès que quelque chose lui apparaît comme une vérité. Il s’agit ici d’un sentiment subjectif relatif à son expérience sensorielle.
Une autre définition, que nous retiendrons, est la connaissance et la prise en compte du chemin logique parcouru par nos sens et notre pensée quant à une problématique ou à une situation.
Pensée multi-scalaire
Pensée caractérisée par la prise en compte d’échelles multiples, pour tout type de dimension (spatiale, temporelle…), permettant de mener à un raisonnement global et le moins relatif possible.
Égoïsme affectif
Phénomène se traduisant par un besoin d’attention et d’affection par des éléments extérieurs, vivants ou non, d’un être pensant pour son propre bien-être.
Aimer un autre être pensant et aimer l’affection d’un autre être pensant sont deux choses distinctes, la première étant empathique, la seconde étant égoïste.
Dogme
Un dogme est une théorie non démontrable par la logique.
Logique
La logique est l’explication d’une relation de cause à effet par un raisonnement cohérent contextualisé.
Société
Ensemble de liens relationnels dans lequel évoluent des êtres pensants, conditionnés par des règles implicites et explicites communes et variables.
Pensée
La pensée est un phénomène caractérisé par le traitement d’informations sensorielles et par leur mémorisation.
Individualisme
Tendance à considérer les individus comme des êtres pensants uniques, par opposition à la collectivité.
Un individualisme sain permet la prise en considération des spécificités de chaque individu plutôt que d’imposer un modèle.
Loi universelle
Règle de vie susceptible de s’appliquer à tout être. Nous emploierons ici ce terme pour définir les règles cadrant le bien libre (cf. section « Le bien et le mal »).